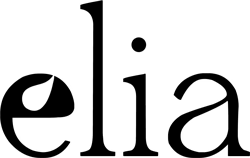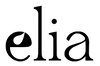La matrescence qu'est-ce que c'est ? Comment gérer ?

📌 Points clés à retenir
La matrescence désigne la transition psychique et émotionnelle que vit une femme lorsqu'elle devient mère. Ce passage, souvent méconnu, suscite de nombreuses émotions et questionnements. Il est normal de douter, de ressentir un attachement progressif, et d'être confrontée à des bouleversements identitaires. Le soutien, l'écoute et la reconnaissance de cette période sont essentiels pour accompagner les jeunes mamans dans cette étape de vie complexe mais riche de sens.
Quand devient-on mère ?
Le mot « matrescence », forgé dans les années 1970 par l’anthropologue américaine Dana Raphael, désigne ce moment si particulier où une personne commence à se percevoir comme parent. Il ne s’agit pas d’un simple changement de statut, mais bien d’un cheminement personnel, intérieur, parfois bouleversant.
Cette période, souvent méconnue, s’accompagne d’un grand nombre de sensations et de questionnements. Il est courant de passer par des phases de fragilité psychique ou de désorientation : fatigue persistante, doutes, isolement, troubles liés au sommeil ou même, dans certains cas, symptômes proches d’un épuisement postnatal.

Contrairement aux idées reçues, nouer un lien affectif avec son bébé peut prendre du temps. L’attachement n’est pas toujours immédiat, et cela ne remet en rien en cause la capacité à aimer ou à prendre soin. Se sentir dépassé·e n’est pas un signe de faiblesse, mais une réaction humaine face à une réalité nouvelle et exigeante.
Ce parcours n’est jamais identique d’une personne à l’autre. Pourtant, dans nos sociétés, la pression liée au modèle de « parent parfait » reste très présente. Cela peut nourrir des doutes, voire une forme de solitude intérieure. Accueillir ce vécu sans se juger est essentiel.
La parentalité peut être ambivalente, mêlant joie, confusion et parfois incompréhensions. Il est sain et même nécessaire de reconnaître cette complexité. Chacun·e est en droit de cheminer à son rythme, avec ses propres repères. D’ailleurs, certaines personnes peuvent ne jamais éprouver l’envie d’avoir un enfant, et cela mérite autant de respect.
Découvrez notre vidéo avec Tziganette sur le sujet :
Comprendre la matrescence : définition et grandes phases
La matrescence est un concept encore méconnu qui désigne la transformation profonde que vit une femme lorsqu’elle devient mère. Ce terme, issu de la contraction entre « maternité » et « adolescence », souligne la complexité de cette période de transition. Il s’agit d’une véritable métamorphose, mêlant bouleversements hormonaux, changement de rythme de vie, remaniement identitaire, et redéfinition du rôle dans la cellule familiale.
Ce processus se déroule souvent en plusieurs phases. La première est celle de la rupture, marquée par un détachement progressif des repères antérieurs : autonomie, carrière, vie sociale. Ensuite, la phase d’adaptation survient, durant laquelle la personne prend conscience de son nouveau rôle de parent, avec tout ce qu’il implique : responsabilités accrues, nouvelles priorités, ajustements émotionnels. Enfin, la phase d’intégration permet d’unifier ces différents aspects pour construire une nouvelle identité stable et alignée, dans laquelle coexistent les différentes facettes de soi : femme, mère, conjointe, professionnelle, etc.
Chacune de ces étapes peut être vécue différemment selon le vécu personnel, l’histoire familiale, les ressources disponibles et le contexte de naissance. Reconnaître l’existence de ces phases aide à normaliser cette évolution intérieure, qui mérite d’être valorisée au même titre que d’autres grandes étapes de vie, comme la puberté ou l’adolescence.

Les répercussions émotionnelles et psychiques de la matrescence
La matrescence, en tant que période de transition intense, peut entraîner un véritable bouleversement émotionnel. Après l’accouchement, de nombreuses jeunes mères se trouvent confrontées à une charge mentale importante, à des remises en question profondes, ou à une instabilité intérieure difficile à exprimer. Même celles qui se sentent « prêtes » peuvent être surprises par l’ampleur des changements. Les émotions sont souvent décuplées : sensibilité accrue, larmes inexpliquées, anxiété ou encore irritabilité peuvent survenir sans préavis.
Sur le plan psychique, cette phase peut réveiller des blessures enfouies ou réactiver des souvenirs liés à l’enfance, à la relation avec ses propres parents ou à des événements marquants du passé. L’image de soi évolue, parfois de manière inconfortable, car elle se confronte aux injonctions sociales et aux attentes idéalisées autour de la parentalité.
Il est essentiel de rappeler que ces réactions sont normales. Elles ne traduisent ni une faiblesse ni un échec. Au contraire, elles sont les signes d’une réorganisation intérieure profonde. Des troubles du sommeil, une baisse de l’estime de soi ou un sentiment de déconnexion peuvent apparaître temporairement, notamment en cas de fatigue chronique ou de solitude.
Pour préserver sa santé mentale, il est crucial d’être entourée, écoutée, et, si besoin, accompagnée par des professionnels formés à ces enjeux. Des ressources variées existent aujourd’hui : groupes de parole, soutien psychologique post-partum, consultations en parentalité, ou encore contenus spécialisés comme des podcasts ou des modules d’écoute bienveillante. En parler, c’est déjà commencer à aller mieux.
Matrescence et adolescence : des transitions identitaires comparables
À bien des égards, le chemin vers la parentalité ressemble à celui de l’adolescence. Ces deux périodes sont marquées par une grande instabilité, des transformations profondes, et une nécessité de redéfinir sa place dans le monde.
Tout comme l’adolescent construit son autonomie, la personne qui devient parent doit trouver de nouveaux repères, souvent en rupture avec ce qu’elle connaissait auparavant. Cette analogie aide à comprendre que le déséquilibre n’est pas une faiblesse, mais une étape naturelle de réorganisation intérieure.
Quand Anne s'est sentie maman
C’est ce que nous confie Anne Raynaud, médecin psychiatre. Fondatrice et directrice des Instituts de la Parentalité en France (Bordeaux & Paris). Elle propose des programmes d’accompagnements à la parentalité, des consultations aux parents de jeunes enfants et la formation des professionnels, afin de répondre aux problématiques spécifiques de la parentalité et à la construction du lien d’attachement.
“Le désir d’enfant : que de questionnements intérieurs. Être parent, voilà qui semble être une sacrée aventure… Être parent, c’est « tout simplement » l’histoire d’une rencontre. Une rencontre intime avec soi-même, à travers le regard de mon enfant, cet être, à qui je donne vie et qui me fait le cadeau de me découvrir.
Cette idée, si lointaine d’avoir un enfant, commence à s’intensifier en moi, depuis quelques temps. C’est assez curieux à décrire, tellement c’est évident et en même temps, un peu bizarre. Les questions se bousculent et puis, elles s’estompent. Mais quelles questions pourraient bien freiner cet élan, que je ressens au plus profond de moi : désirer un enfant ?
Parfois, les conditions semblent réunies. Mon/Ma partenaire est là, bien présent(e) dans ma vie, j’ai enfin le sentiment d’avoir une stabilité professionnelle et c’est juste le bon moment. C’est aussi le moment où nous construisons notre nid douillet, pour cette nouvelle famille. Tout arrive en même temps, c’est parfois un peu beaucoup dans ma tête, mais quelle joie de voir notre couple se transformer en famille et de voir grandir notre amour, à travers ce désir d’enfant.
Et puis, pour d’autres, c’est un peu une surprise, ou bien alors, tous les critères rationnels ne semblent pas présents dans mon existence et pourtant, c’est maintenant, que je me sens appelé(e) dans cette grande aventure.
Changer de vie, donner naissance à un petit être que nous allons fabriquer, qui va prolonger l’intensité de notre amour et transformer nos vies, est-ce bien raisonnable ? C’est vrai, que je ressens si souvent à l’intérieur de moi, comme un combat entre l’envie irrépressible de donner la vie et dans le même temps, tout ce que cela va transformer. Changer mes habitudes, ne plus avoir la liberté de sortir ou de faire du sport, quand j’en ai envie, toutes les contraintes inhérentes à l’arrivée d’un petit bébé sur mon sommeil par exemple, la réorganisation matérielle de nos vies… Mais qu’importe, je me sens prêt(e).
C’est donc normal d’éprouver cette envie teintée d’hésitation. C’est juste que je touche au fond de moi, que cet engagement va changer ma vie. Il est donc essentiel, que je ressente en moi, tous ces questionnements. Ce n’est pas que je ne veuille pas, ce bébé, dont je rêve. C’est juste que, par ces interrogations profondes, je prends la dimension de cette grande aventure. Parfois même, il est déjà en moi, quand je me sens indécis(e) et incertain(e) à poursuivre la grossesse. Je m’en veux de penser que je ne souhaite peut-être pas cet enfant. Mais ces idées et ces doutes ne se construisent pas à l’encontre de ce bébé, déjà en moi, mais témoignent du sentiment de responsabilité qui commence à s’installer, maintenant que cette voie vers la parentalité se met en place. C’est, au contraire de la culpabilité, l’émergence d’un sentiment essentiel d’implication, vis-à-vis de cet enfant à venir. Ces questions sont essentielles et il est fondamental de se les poser en conscience dès le début. C’est le signal que je commence déjà ma préparation à devenir parent. Mon bébé ne peut pas m’en vouloir de me demander si je me sens prêt(e) à l’accueillir. Au contraire, c’est un joli cadeau.
J’ai donc bien compris, désirer une enfant, c’est un peu complexe et ambivalent : entre une envie irrépressible et une peur de ne pas y arriver. Mais quand même, quelle expérience et nous apprendrons ensemble…”
Découvrez notre podcast dédié à la matrescence avec Floriane Stauffer :
Si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d’un soutien psychologique, n’oubliez pas que des professionnels de la santé sont là pour vous aider.
Pour toutes les étapes de votre vie, de la grossesse au post-partum, Elia vous accompagne avec une collection de lingerie menstruelle délicate pour votre peau, dans les moments les plus sensibles.
Conseils pour traverser sereinement la matrescence
Pour mieux vivre la matrescence, il est essentiel de s’écouter, de ralentir et de s’autoriser à ressentir. Accepter que l’adaptation prenne du temps permet de diminuer la pression. Il est utile de s’entourer de personnes bienveillantes et d’échanger avec d’autres mères, pour rompre l’isolement.
Des outils comme l’écriture, la méditation, ou l’accompagnement par une sage-femme, une psychologue ou une doula peuvent favoriser cette transition. Enfin, garder à l’esprit qu’il n’existe pas de « bonne » façon d’être mère permet de se reconnecter à sa propre vérité.
La FAQ de la matrescence
Qu'est-ce que la matrescence ?
La matrescence est une phase de transformation identitaire, hormonale, physique et mentale que traverse une personne à l'arrivée d'un enfant. Ce concept, issu de la fusion entre « maternité » et « adolescence », met en lumière les bouleversements profonds vécus dans le quotidien, le corps et le rapport à soi. On peut la comparer à l'adolescence par son intensité et ses remises en question.
Comment la matrescence affecte-t-elle le bien-être mental ?
Cette période peut entraîner de fortes réactions intérieures : troubles du sommeil, perte de repères, vulnérabilité accrue, fatigue émotionnelle. Ces manifestations peuvent évoluer vers un épuisement psychologique si elles ne sont pas accompagnées. Identifier cette étape comme normale permet une meilleure prise en charge du moral des jeunes mères.
Y a-t-il des ressources ou des soutiens disponibles pour les mères ?
Absolument. Des parcours d’accompagnement existent : rendez-vous spécialisés, contenus audio comme le podcast de Clémentine Sarlat, groupes de partage entre parents, réseaux professionnels en santé mentale, sages-femmes, coachs périnataux... En France, les initiatives se multiplient pour entourer les nouveaux parents dans ce cheminement.
Quelles sont les principales réactions vécues pendant la matrescence ?
Les ressentis peuvent être ambivalents : euphorie, inquiétudes, fatigue, solitude, ou encore doutes. Ces réactions sont naturelles face à l’ampleur du changement. Cette étape de vie peut aussi réveiller des souvenirs enfouis, tout en ouvrant un chemin de développement personnel intense.
La matrescence touche-t-elle tout le monde de la même manière ?
Non. Chaque individu vit cette période différemment. Certaines la traversent avec sérénité, d’autres rencontrent davantage de défis. Le contexte, le passé personnel, les soutiens disponibles, l'accouchement ou encore l’histoire familiale influencent cette expérience intime.
Peut-on se préparer à vivre la matrescence ?
Oui, il est possible d’anticiper cette étape. Participer à des rencontres prénatales, écouter des témoignages, consulter des spécialistes, ou simplement prendre le temps de réfléchir à ce nouveau rôle permet d’aborder cette transformation avec plus de confiance et de lucidité.
Quel rôle joue le partenaire pendant la matrescence ?
Le partenaire joue un rôle primordial : soutien moral, gestion partagée du quotidien, attention portée aux besoins de la mère... La matrescence peut aussi redéfinir les équilibres dans le couple. Une communication claire et bienveillante renforce le lien et aide à mieux traverser cette période de changement.
Est-il normal de ne pas se reconnaître dans son nouveau rôle ?
Oui, il est fréquent de traverser une période de flou ou de décalage après une naissance. L’ajustement à ce nouveau quotidien prend du temps, et il est sain de s’accorder de la patience sans se juger. Chacun évolue à son propre rythme.
Comment en parler à son entourage quand on se sent dépassé(e) ?
Il peut être difficile de mettre des mots sur ce que l'on vit. Choisir une personne de confiance, exprimer ses ressentis sans filtre, ou même écrire une lettre peuvent aider à se faire entendre. Si l'entourage ne comprend pas tout de suite, cela ne remet pas en question la légitimité de ce que vous traversez.
Pourquoi cette période peut-elle être aussi déroutante ?
Elle bouleverse les repères habituels, modifie les priorités, et confronte parfois à des aspects de soi encore inexplorés. Ce chamboulement, bien que naturel, peut surprendre par son intensité et générer un sentiment d’instabilité temporaire.
Faut-il en parler même si l'on n'a pas de "raison valable" de se sentir mal ?
Oui, vos ressentis méritent d’être exprimés, même sans cause précise ou visible. Ce n’est pas la gravité des faits qui détermine la légitimité d’un malaise, mais la manière dont vous le vivez. En parler permet de soulager et de clarifier ce qui se passe intérieurement.
🔬 Sources scientifiques et institutionnelles
-
Dana Raphael :
"Matrescence: Becoming a Mother" (années 1970) – terme introduit pour désigner cette période de transformation. Voir la page Wikipedia -
Organisation mondiale de la Santé (OMS) :
Perinatal mental health – examen des enjeux de santé mentale durant la période postnatale. Lire le dossier OMS -
Inserm :
Enquête nationale périnatale 2021 – rapport offrant des données sur l’état de santé mentale des mères en post-partum. Consulter l’ENP 2021